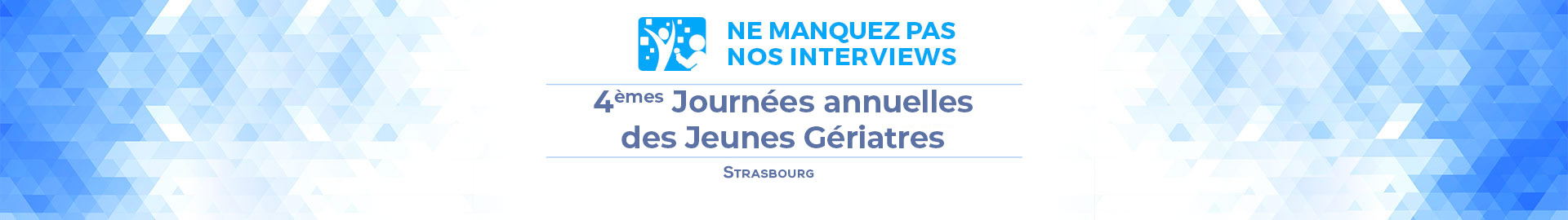Il était un temps où, pour soumettre un article à une revue de gériatrie, il fallait qu’il concerne des personnes « âgées ». Le terme « âgé », qui a donné lieu à d’innombrables débats, n’a toujours pas été tranché ce d’autant que la société, les concepts et la médecine ont évolué et continuent d’évoluer. Un point est certain : l’abandon du critère unique de l’âge chronologique, officiel, est une réalité ! La citation : « Une personne âgée, c’est une personne qui a 15 ans de plus que son propre âge » reste une boutade…
Pour parler de personnes âgées, d’autres critères ont été ajoutés/proposés (polypathologie, fragilité, fragilité sociale ou encore cognitive, vulnérabilité, dépendance fonctionnelle…) aux significations parfois approximatives. Ces qualificatifs font office, notamment sur le plan administratif, de couperet pour l’admission dans diverses structures ou l’obtention de droits (âgisme inversé ?).
« Polypathologique et plus de 75 ans » est souvent cité comme le critère d’admission dans les services de court séjour gératrique porte d’entrée dans une filière reconnue par notre système de santé.
Il demeure des situations difficiles et paradoxales. La Revue de Gériatrie a consacré plusieurs dossiers aux « personnes précaires vieillissantes ». Dans l’étude des grands précaires dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) d’Île-de-France, l’âge moyen de cette population était de 75 ans (extrêmes : 52-86 ans)(1). Une partie de cette population qui était donc jeune (au sens chronologique) sera amenée à vivre avec des personnes d’une autre génération au passé différent et ayant un projet de vie spécifique en lien avec leur génération. Il est alors logique que La Revue de Gériatrie aborde ces problèmes.
L’étude de Jean-Bernard Gauvain(2) concerne 186 personnes (moyenne d’âge : 61 +/– 13,2 ans [48,5-67]) d’un âge assez éloigné des populations gériatriques habituelles, mais de fait à haut risque de chute et ayant une polymédicamentation. Le thème de cette étude, qui porte sur le statut fracturaire de ces patients et leur possible ostéoporose, constitue un modèle de réflexion pour la gériatrie. Les résultats de cette étude descriptive menée dans une population adulte en situation de handicap incitent à rechercher une ostéoporose fracturaire (selon notamment une méthode innovante de diagnostic opportuniste) en identifiant, par exemple, des fractures vertébrales sévères méconnues, et donc à envisager dans ces cas une prévention secondaire de cette ostéopathie redoutable.
Si l’âge (moyen, médian et extrêmes) reste un élément indispensable pour qualifier une population en particulier du fait de sa liaison avec les comorbidités et les syndromes gériatriques) il ne doit plus nécessairement être exclusif pour accepter ou refuser une publication soumise à une revue de gériatrie.
Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêt en rapport avec cet article.
1. Le Noc Soudani M, Caron A. L’accueil des grands précaires dans les Ehpad d’Île-de-France. Rev Geriatr 2024 ; 49 : 457-66.
2. Gauvin JB. Diagnostic opportuniste d’ostéoporose fracturaire dans une population d’adultes en situation de handicap. Rev Geriatr 2025 ; 50 : 5-16.